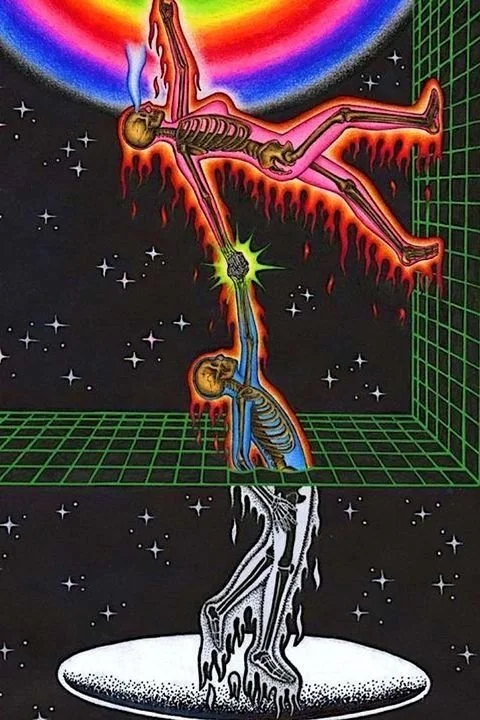Articles
Billet de blog, articles en lien avec nos activités philo-création, nos réflexions et analyses des lectures d’actualité en philo jeunesse, nos événements à venir et galerie de photos !
Juin 2025
Pourquoi et comment
parler aux enfants des animaux ?
La relation historique des êtres humains avec les animaux
Dans La Politique, Aristote écrit qu’« un homme accompli est le meilleur des animaux ». Si les philosophes ont été nombreux.ses à questionner les différences entre les êtres humains et les autres animaux, il n’en demeure pas moins que la tendance générale de l’être humain est, encore aujourd’hui, de se considérer supérieur aux autres espèces. En effet, la réflexion d’Aristote n’est pas isolée, et des penseurs comme Descartes au XVIe siècle, ou Heidegger de façon plus contemporaine au XXe siècle, ont eux-mêmes participé à cette théorie humaine de suprématie sur les autres espèces. Le premier, dans des textes comme le Discours de la méthode ou la Lettre au marquis de Newcastle, estime que les animaux sont dépourvus de conscience et sont incapables de ressentir douleur ou plaisir : les animaux seraient des machines qui, pareilles aux horloges, réagiraient de manière naturelle sans penser, ni rien éprouver. Quelques siècles plus tard, dans ses Concepts fondamentaux de la métaphysique, le second qualifie l’animal d’« étrange végétal ». Pourtant, depuis quelques années, a (ré)-émergé le concept de sentience pour désigner la capacité d’un être vivant à éprouver des choses subjectivement. Un être sentient, qu’il soit humain ou non, peut ressentir les émotions, la douleur ou encore le plaisir et percevoir son environnement et ses expériences de vie. On reconnaît à présent aux animaux certains droits qui ne leur étaient jusque-là pas accordés. La frontière entre l’être humain et les autres animaux semble de ce fait de plus en plus floue.
Les questions portant sur les animaux sont intéressantes à aborder avec les enfants car iels sont généralement, dès leur plus jeune âge, les premier.ère.s à être révolté.e.s par les propos qu’ont pu tenir un Descartes ou un Heidegger et à se soucier du bien-être animal. En effet, les œuvres littéraires ou cinématographiques destinées aux enfants se singularisent par leur anthropomorphisme, ainsi que les peluches, qui prennent la plupart du temps la forme d’animaux. De la même façon, le pourcentage des animaux de compagnie vivant avec nous ne cesse
d’augmenter d’année en année. Les enfants sont donc bercé.e.s par les histoires peuplées d’animaux qui leur sont racontées et apprennent très tôt à apprécier la présence animale. Un décalage est alors créé entre à la fois la proximité que nous avons avec les animaux et l’infériorité que nous leur attribuons. Est-il réellement possible de concilier ces deux aspects ?
La question que nous choisissons de poser aux enfants porte sur cette notion de frontière, de différence entre notre espèce et les autres : les animaux sont-ils différents de nous ?
Quelles différences entre les êtres humains et les animaux ?
La façon classique d’entrer en la matière est de demander et d’établir avec les enfants ce qu’est un être humain puis ce qu’est un animal. Le terme « animal » vient du latin anima qui signifie « souffle, âme ». L’anima est donc ce qui insuffle la vie à une créature, qu’il s’agisse d’un animal
ou d’un être humain. Nous savons que l’espèce humaine est une espèce animale elle-même, alors quelles différences faire avec les autres animaux ? D’une part, nous pouvons dire que si l’on retrouve certaines caractéristiques communes telles que les sens, ces derniers ne sont pour autant pas développés de la même manière chez tous les animaux : par exemple, le goût des chiens est nettement moins développé que le nôtre, en revanche leur odorat l’est beaucoup plus. Mais au-delà des caractéristiques communes pouvant se distinguer sur certains aspects, des attribut peuvent être qualifiés de spécifiquement humains. Parmi eux notamment, nous retrouvons le langage, la pensée
ou encore la culture au sens large (art, avancées technologiques, etc.).
Toutefois, même ces critères proprement humains pourraient être interrogés. En effet, les animaux n’ont-ils pas également leur propre langage ? Qu’il s’agisse des oiseaux qui sifflent ou des abeilles qui parviennent à communiquer entre elles par la danse par exemple. De la même manière, ne retrouve-t-on jamais d’art dans le règne animal ? Nous pouvons penser au poisson-globe, qui crée de véritables œuvres d’art sur le sable dans un but de séduction. De même, récemment, une femelle orang-outan, Nénette, a été observée en train de dessiner à la Ménagerie du Jardin des Plantes. Les animaux pourraient-ils donc être artistes ?
Boris Cyrulnik a déclaré : « Ce qui distingue l’homme de l’animal, c’est la parole. Non pas le langage, car les animaux ont aussi un langage. Mais l’aptitude à créer un monde spécifiquement humain par des représentations verbales : le monde des mots. Darwin, dès ses premiers travaux, a parlé du “ mur du langage ”. »
Si le langage peut être retrouvé dans le monde animal, les mots, quant à eux, seraient spécifiquement humains. Avec eux viennent la pensée et notre capacité de raisonnement. Ceci étant dit, il n’est pas certain que les animaux ne pensent pas ou ne rêvent pas. Dans la mesure où cette hypothèse est difficilement vérifiable, nous pouvons toutefois soutenir que le raisonnement humain est certainement plus poussé que celui des autres animaux. Malgré tout, cela nous donne-t-il le droit, comme le soutient Aristote, de nous considérer comme « le(s) meilleur(s) des animaux » et ainsi, dans une perspective spéciste, de pouvoir traiter les animaux comme des êtres vivants qui n’en seraient pas ?
Le spécisme et l’antispécisme
Le spécisme est un concept défini sur le modèle du racisme et du sexisme, plaçant l’espèce humaine au-dessus de toutes les autres et accordant une considération morale plus grande à certaines espèces animales qu’à d’autres. Depuis les années 1970, est né par opposition l’antispécisme, un courant de pensée moral, porté notamment par Peter Singer, qui considère que l’espèce d’un animal n’est pas
un critère de considération moral pertinent pour décider de la manière dont il doit être traité. Dans La Libération animale, Peter Singer pose le principe moral fondamental de la considération égale d’intérêts similaires afin de défendre sa position antispéciste. Une égale considération envers des êtres différents implique que nous accordions les mêmes droits à deux groupes distincts présentant une même caractéristique. Cela ne veut pour autant pas dire que nous accordions absolument tous les mêmes droits aux espèces de deux groupes différents. Les chiens n’ont pas d’intérêt à voter par exemple, car les lois relatives à l’espèce humain ne les concernent pas, et qu’ils n’ont pas la capacité à examiner un programme politique comme nous pourrions le faire. Pareillement, les jeunes enfants ne votent pas, car iels n’en ont pas non plus les capacités. Cela n’empêche cependant pas de reconnaître à ces deux groupes un principe d’égalité plus fondamental lié à la souffrance. De la même manière qu’il n’y a aucune raison de faire souffrir un.e jeune enfant parce qu’il n’est pas en capacité de raisonner assez pour voter, il est aussi absurde d’accepter de faire souffrir un chien car ce dernier n’a pas le droit de vote. La question à se poser n’est pas : « peuvent-ils raisonner ? » ou « peuvent-ils parler ? » mais « peuvent-ils souffrir ? ». Si un être vivant est capable de ressentir de la souffrance, alors nous partageons avec lui au moins une caractéristique commune. De ce fait, nous devrions lui accorder les mêmes droits que nous en terme de non-souffrance.
✸ Portrait du Teckel Pehr - Jean-Baptiste Oudry, 1740
✸ Héloïse et Abelard - Gabriel Von Max, 1915
✸ Le Jockey - Henri de Toulouse-Lautrec, 1899
Pour préparer un atelier philosophique sur ce sujet nous vous conseillons :
Le chapitre 3 « La frontière entre l’homme et l’animal existe-t-elle ? » de notre livre : 50 activités pour philosopher avec ses enfants (First, 2020).
Les chapitres 1, 4, 5 et 6 de La Libération animale de Peter Singer. : https://www.fnac.com/a4425705/Peter-Singer-La-Liberation-animale
Le court traité sur les animaux, Manger la chair ?, de Plutarque.
La série France Inter « Les animaux et les hommes » : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/serie-les-animaux-et-les-hommes
Suzie Ferry
✸
Février 2025
Pourquoi et comment parler de l’univers aux enfants ?
Comment parler de l’univers aux enfants d’un point de vue philosophique et pourquoi ? Comment aborder un sujet si vaste et qui “n’existe que sur le papier” comme le disait Paul Valéry ?
La raison première qui motive le choix d’aborder en atelier philosophique un sujet portant sur le ciel, l’observation du ciel ou l’univers tient d’une part au fait que ce sujet passionne beaucoup d’enfants. Dès la grande section de maternelle et tout au long des premières années de primaire, les enfants questionnent l’origine des choses : comment est né le soleil ? Qu’y a-t-il dans l’univers ? Sommes-nous seuls ?
Qu’y avait-il avant la naissance des étoiles et des planètes ?
Ces interrogations ressemblent à la question déroutante et célèbre du philosophe Leibniz : pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?
Réfléchir à la question de l’origine de l’univers en tant que totalité de ce qui existe revient à se poser une question philosophique, celle de la génération (et de la naissance) : comment quelque chose peut-il émerger du néant, du rien ?
C’est aussi une matière inépuisable de questionnements qui remet à jour l’origine et la fonction des mythes. Les mythes, disait Claude Lévi-Strauss “tendent à fonder, par ce qui s’est passé à l'origine du temps, la raison pour laquelle les choses sont comme elles sont”. On a longtemps et dans de nombreuses cultures vu et lu des signes dans le ciel qui expliquaient l’organisation de la société des hommes, leur rapport aux divinités et aux puissances naturelles. Le ciel était le miroir du monde terrestre et son explication mouvante.
✸ “ Ring Nebula ” - télescope spatial James Webb
✸ Jupiter - image du télescope spatial James Webb
Pour aborder un sujet aussi vaste avec des enfants il est primordial de bien choisir l’axe et la question qui initie l’atelier philosophique.
Au risque de se perdre dans des dizaines de questions sur les objets célestes et que la discussion philosophique ne se transforme en “foire aux questions” - certes intéressantes et/ou fantasques, il est préférable de choisir un axe clair.
Observer le ciel, est-ce une évasion ?
Nous choisissons depuis plusieurs années de poser cette question spécifique. Elle est intéressante car elle indique que l’observation du ciel n’est pas une stricte contemplation ou une recherche de connaissance scientifique, mais qu’à plusieurs égards cette observation conduit à “s’évader”, par l’imagination - certes, mais aussi de notre condition d’être fini en pensant à ce que nous serions, si nous pouvions “quitter la Terre”. À ce sujet, le prologue de La condition de l’homme moderne d’Hannah Arendt nous indique l’idée sous-jacente de la volonté d’explorer l’espace : en 1957, après le lancement du satellite Spoutnik 1, un journaliste se réjouit et exprime son soulagement à l’idée de pouvoir s’évader “de la prison terrestre”. L’idée n’est pas anodine, Hannah Arendt s’y arrête longuement.
Il faut être préparé à des questions parfois pointues : qu’est-ce qu’un trou noir ? Combien y a-t-il d’étoiles dans l’univers ?
Quelle est la différence entre une étoile et une planète ? Comment se forme une étoile ? Qu’est-ce que le big bang ?
L’univers a-t-il une forme ? Une fin ? etc.
✸ Nebulose_NGC 602 - par télescope spatial James Webb
S’il s’agit d’un atelier philosophique, il est néanmoins de toute importance de ne pas négliger ces questions mais d’y répondre - quand c’est possible ! Tout en ramenant ces questions à la question philosophique posée.
Ce sujet est d’une immense richesse d’un point de vue philosophique. Ce n’est pas un hasard qu’il ait été au cœur des préoccupations des philosophes de l’Antiquité, ni qu’il y ait eu de nombreux philosophes à observer le ciel et polir des lentilles… S’interroger sur l’origine de l’univers visible et la place de l’humain au sein de cette énigme fondamentale nous ramène au vertige du philosophe Pascal mais aussi à la quête de savoir, d’aventure, et de l’imaginaire qui se confronte à ces “espaces infinis”.
Pour préparer un atelier philosophique sur ce sujet nous vous conseillons :
Le chapitre 7 “Observer le ciel, est-ce une évasion ? ” de notre livre : 50 activités pour philosopher avec ses enfants (First, 2020).
La lecture du prologue de La condition de l’homme moderne d’Hannah Arendt
Un livre pour enfants afin d’aborder des questions scientifiques sur le ciel (Les copains du ciel) : https://www.editionsmilan.com/livres/58106-copain-du-ciel/
Le site du Centre National d’Études Spatiales (CNES) et en particulier les podcast “Raconte-moi l’espace” : https://podcast.cnes.fr/raconte-moi-lespace/
Le formidable livre de Fatoumata Kebe : Au-delà du ciel qui explique et montre des images du télescope James Webb (JWST)
La série France Culture “Aux origines de la conquête spatiale” : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/aux-origines-de-la-conquete-spatiale-9593070
Le visionnage des émissions scientifiques de la chaîne ARTE sur l’espace et en particulier la série “Une espèce à part” : https://www.arte.tv/fr/videos/075786-001-A/une-espece-a-part/
Fanny Bourrillon
✸
Sept. 2024
Pourquoi et comment
parler aux enfants de l’Intelligence Artificielle ?
L’Intelligence artificielle nous fascine car elle imite l’intelligence humaine tout en étant beaucoup plus performante pour effectuer certaines tâches. Se développant à toute vitesse, les nouvelles technologies dotées d’une intelligence artificielle mettent au défi l’humain dans de nombreux domaines. Cependant, peut-on dire qu’une IA « pense » ? Est-elle consciente d’elle-même ? Qu’est-ce qui fait encore la singularité humaine et pour combien de temps ? Ces questions, difficiles de prime abord, nécessitent un premier temps de présentation et d’explications. Pour un sujet aussi technique et en constante évolution, il est impératif de s’assurer que les enfants comprennent de quoi il s’agit, ce que l’IA peut ou ne peut pas faire, ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas.
Par conséquent, voici, dans un premier temps, la question que nous soumettons aux enfants (dès 7 ans) : Qu’est-ce qu’une Intelligence Artificielle ? Si certain.es le savent et parviennent à dire qu’il s’agit de techniques informatiques qui imitent le fonctionnement du cerveau humain, d’autres n’en ont qu’une idée vague. Nous proposons alors dans un premier temps de visionner quelques courtes vidéos explicatives afin de déblayer le terrain et de partir sur de bonnes bases avant la discussion philosophique (ressources à la fin de ce billet). Il est aussi possible de proposer une présentation de 15 à 20 minutes, questions comprises, afin de définir strictement ce qu’est une intelligence artificielle, ce qu’elle n’est pas, mais aussi de questionner les enfants et de compléter leurs réponses quant à la question suivante : où se trouve l’IA ? (Dans quels objets, sur quelles applications, plateformes etc.). Il est important à ce stade de préciser qu’il n’y a pas d’IA dans chaque objet robotisé. Il y en a en revanche dans de nombreux jeux vidéos, de très nombreuses applications (Meta, ChatGPT). Et celle-ci ne s’applique pas à un seul domaine puisque l’intelligence artificielle s’intègre partout : dans les arts (Dall-E) avec la création de peintures, d’images, de sculpture ou de musique ; dans la médecine avec des outils d’analyse et de prédiction d’une maladie (et même la chirurgie assistée par ordinateur) ; dans les mathématiques (AlphaGeometry) ; dans des applications de recettes culinaires, dans les voitures autonomes, dans les services de cartographies en ligne (GoogleMaps) [...].
Une fois cette partie introductive passée, nous posons la question “Est-ce qu’une Intelligence Artificielle pense ?”
Cette question soulève de nombreuses définitions à poser et distinctions à opérer. Il convient de définir le mode opératoire d’apprentissage des IA (IA apprenantes) et de le comparer à nos facultés d’apprentissage. Il convient également de distinguer le réflexe et la réflexion par exemple : la vitesse à laquelle chatGPT compose un poème et le temps que nous y mettrions. Encore, la définition de ce que c’est que penser, mais également une définition de l’intelligence humaine à la différence d’une intelligence artificielle qui est conçue et pensée dans le but de nous faire gagner du temps ou de servir un intérêt précis.
Pourquoi aborder ce sujet avec les enfants ?
Parce qu’ils en entendent beaucoup parler d’une part et parce qu’ils y sont déjà ou y seront confrontés.
Le premier enjeu de la discussion philosophique est de distinguer le vrai du faux sur l’IA. Les enfants imaginent un robot omniscient. Ils imaginent que les assistants conversationnels comme Alexa (Amazon) ont une forme de conscience - certains en ont même peur ! Il s’agit alors de démystifier les capacités des IA à ce jour, pour se confronter à des questions plus importantes : qui pense “avec” les intelligences artificielles ? Quels buts servent-elles ? Hormis le gain de temps et l’efficacité, on sait aussi que les IA peuvent être très efficaces pour répandre ou produire de fausses informations (et servir des acteurs malveillants).
La raison majeure et l’urgence à parler aux enfants d’Intelligence Artificielle tient au développement galopant d’un futur synthétique proposant des images et des audios créés de toute pièce faisant croire à une réalité alternative. Cette réalité synthétique - communément appelée deepfakes peut faire parler n’importe quel visage en imitant ses expressions, elle peut aussi revêtir une voix bien connue et “faire parler”. Le problème : ces mises en scènes peuvent paraître tout aussi plausibles que la réalité physique au point où il sera probablement bientôt difficile de distinguer le vrai du faux, une vraie image d’une fausse, un visage réel d’un visage purement synthétique. Ce bouleversement absolument inédit de nos perceptions doit conduire à une rapide formation des esprits, à une “pratique des images” pour la simple et bonne raison qu’il en va de notre perception du monde, de l’actualité, et de notre faculté de juger, et de former une société démocratique.
Quelques mots sur le contenu de la partie philosophique :
Il est intéressant alors de proposer aux enfants de penser ce que c’est que l’intelligence humaine dans son ensemble, c’est à dire n’étant pas seulement capable de résoudre des problèmes, ni surtout de distinguer le vrai du faux, le juste de l’injuste, de savoir faire face à des situations complexes nécessitant un regard critique. À ce stade, nous proposons aux enfants de réfléchir à ce que c’est que “comprendre” (-prehedere, “saisir”/ -cum, “avec”).
En progressant dans la réflexion collective, c’est l’intelligence et la sensibilité humaine qui est mise au jour, sa “singularité”, mais aussi celle d’autres espèces intelligentes.
Les enjeux sont multiples : questionner le “meilleur des mondes” et les promesses des entreprises qui mobilisent des IA, distinguer les risques réels des risques fictifs, et de mesurer les défis que ces nouvelles technologies entraînent.
À propos de cet atelier : nous le proposons depuis 2018 à la bpi Centre Pompidou pour adolescents. En 2024, nous le proposons lors du printemps de l’esprit critique à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris pour des groupes scolaires et enfants du CE2 au CM2.
Ressources :
Ces deux ressources sont volontairement courtes pour introduire la première partie :
C’est quoi l’intelligence artificielle ? (curionautes des sciences - Milan Jeunesse) :
https://www.youtube.com/watch?v=PBJ9_G8d6mo
Qu’est-ce qu’un réseau de neurones artificiels (sorbonne université), 2 minutes :
Un article afin de nourrir la discussion préparatoire à l’atelier philo :
Pour approfondir le sujet nous vous conseillons :
“La course à l’IA : vers le meilleur des mondes ?”
https://www.arte.tv/fr/videos/115067-000-A/course-a-l-ia-vers-le-meilleur-des-mondes/
Sur les Deepfakes :
https://www.arte.tv/fr/videos/118634-000-A/deepfakes-la-nouvelle-donne/
Fanny Bourrillon
✸